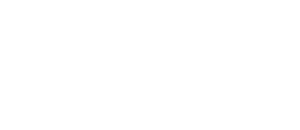L’intersection de l’art de la bande dessinée et de l’innovation des expositions universelles peut sembler improbable, mais les Peanuts de Charles M. Schulz et l’Exposition universelle de Paris de 1900 révèlent comment le design imprègne même les recoins les plus inattendus de la culture. Du pull en zigzag de Charlie Brown à la structure en treillis de fer de la tour Eiffel, ces pierres de touche démontrent que le design réfléchi transcende les supports, les époques et les publics.
Les personnages de Schulz, qui célèbrent aujourd’hui leur 75ème anniversaire, ont longtemps été des vecteurs de commentaires subtils sur le comportement humain. Leur rôle d’icônes de la mode malgré elles est moins connu. L’exposition « Snoopy et le style : une histoire des Peanuts et de la mode », qui se tiendra à Paris du 22 mars au 5 avril, dévoilera cet héritage. Les débuts de Snoopy en 1950 avec son col à fleurs ont évolué vers des collaborations avec Giorgio Armani, Dries Van Noten et Balenciaga, transformant le beagle en une toile d’expérimentation de la haute couture. Le pull indémodable de Charlie Brown, une étude de simplicité géométrique, reflète les lignes épurées du modernisme du milieu du siècle, tandis que les sandales et les shorts de Peppermint Patty défiaient les codes vestimentaires des décennies avant la mode non genrée des années 1970. Le travail au trait de Schulz, décrit par son collaborateur Tom Everhart comme « une lumière tachetée », fusionnait la bande dessinée avec l’expressionnisme abstrait, prouvant que même des traits minimalistes pouvaient transmettre de la profondeur.
Pendant ce temps, Paris associait sa réputation de haut lieu du design à l’Exposition universelle de 1900. S’étendant sur 219 hectares, l’exposition présentait l’Art nouveau au grand public et mettait en valeur des prouesses techniques telles que le pont Alexandre III. Le Palais de l’électricité, un monument lumineux et innovant, fusionnait les machines industrielles avec des ornements mythologiques : des hippogryphes couronnaient son toit et crachaient des flammes colorées. Bien que temporaires, ces structures ont redéfini l’esthétique urbaine, influençant tout, des arches des stations de métro aux espaces commerciaux actuels en verre et en acier. L’accent mis par l’exposition sur le design expérientiel, dans lequel les visiteurs parcouraient les pavillons comme des récits immersifs, préfigurait les installations interactives modernes.
Qu’est-ce qui relie les bandes dessinées de Schulz à une exposition universelle vieille de 124 ans ? Toutes deux s’appuient sur la sobriété et la clarté pour laisser une impression durable. Le treillis de la tour Eiffel, initialement critiqué pour son aspect squelettique, est devenu un modèle de transparence structurelle en architecture. De même, les planches épurées de Schulz, qui ne dépassaient que rarement quatre cases, exigeaient une grande précision dans la narration visuelle. Jean-Charles de Castelbajac, dont les pulls Snoopy de 1981 fusionnaient le texte shakespearien avec le pop art, a noté que les personnages de Schulz se nourrissaient d’une « simplicité calculée ». Cette philosophie résonne dans le Grand Palais de l’exposition 1900, où les nervures de fer et les panneaux de verre créent une luminosité sans ornement.
Les designers modernes continuent d’exploiter ces deux héritages. La galerie de Steven Holl à Séoul, inspirée de la notation musicale, fait écho à l’audace thématique de l’exposition, tandis que les collaborations d’Uniqlo avec Peanuts réinterprètent les motifs de Schulz pour le streetwear. L’accent mis par l’exposition 1900 sur le spectacle technologique trouve également des parallèles dans l’architecture intelligente d’aujourd’hui, où la forme suit de plus en plus la fonction numérique.

Des critiques tels que Philip Kennicott, qui met l’accent sur le contexte dans l’évaluation de l’art et du design, pourraient soutenir que l’œuvre de Schulz et l’architecture de la foire partagent une philosophie démocratique. La bande dessinée Peanuts a touché des millions de personnes par le biais des journaux, tout comme l’Exposition universelle de Paris a attiré 50 millions de visiteurs. Ces deux plateformes ont élevé des expériences quotidiennes – les peurs de l’enfance, le progrès industriel – au rang de monuments culturels. Le plaidoyer de Kennicott en faveur du « temps et du silence » dans l’art engageant s’applique ici : le poids d’une ligne de Schulz ou le balayage d’une arche rivetée exigent un examen plus lent.
Pourtant, les contradictions abondent. Le Palais de l’électricité de l’Exposition universelle de 1900, malgré sa grandeur, a été démantelé en quelques mois, rappelant que tous les designs ne résistent pas à l’épreuve du temps. Peanuts, quant à lui, ne cesse d’être réinventé, ses personnages se transformant en muses du luxe et en mascottes de missions spatiales. Cette tension entre permanence et éphémère définit l’évolution du design.
Les passionnés d’aujourd’hui peuvent en tirer des enseignements. Les bandes dessinées de Schulz, qui comptent plus de 18 000 numéros, montrent comment la cohérence engendre la reconnaissance, un principe exploité par des marques telles qu’Apple et Braun avec Dieter Rams. Les Expositions universelles de Paris, bien qu’en grande partie démolies, soulignent l’importance de la prise de risque ; la tour de Gustave Eiffel, qui ne devait durer que 20 ans, est devenue éternelle parce qu’elle a osé s’aliéner avant d’inspirer.
À l’ère de l’esthétique algorithmique, un retour à ces racines offre une certaine clarté. La conviction de Schulz selon laquelle « chaque marque représente le temps » s’applique aussi bien aux bandes dessinées dessinées à la main qu’aux façades imprimées en 3D. Le design, qu’il soit à l’encre ou au fer, reste un dialogue entre le créateur et le public, dans lequel la simplicité est souvent la plus éloquente.