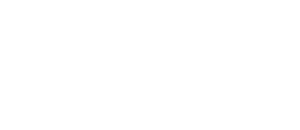Les géants chinois de la mode à bas prix Shein et Temu adaptent massivement leurs stratégies marketing à l’Europe, notamment la France et le Royaume-Uni, en réponse aux nouvelles politiques douanières américaines. Cette réorientation stratégique, révélée par des données exclusives de Sensor Tower transmises à Reuters, marque un tournant majeur pour ces plateformes de commerce en ligne.
En avril dernier, Shein a augmenté ses dépenses publicitaires de 35 % dans ces deux pays. Temu, propriété du groupe PDD, affiche une hausse encore plus significative avec une augmentation de 40 % au Royaume-Uni et de 20 % en France par rapport au mois précédent. Sur une base annuelle, les investissements publicitaires de Temu ont augmenté de 115 % en France et de 20 % au Royaume-Uni, tandis que ceux de Shein ont augmenté de 45 % en France et de 100 % au Royaume-Uni.
Ce repositionnement survient dans un contexte particulier. L’administration Trump a récemment supprimé l’exemption douanière dite « de minimis », qui permettait jusqu’alors l’entrée aux États-Unis de colis d’une valeur inférieure à 800 dollars sans droits de douane. Cette mesure, entrée en vigueur le 2 mai, affecte directement le modèle économique de ces plateformes spécialisées dans la vente de vêtements et d’accessoires à prix ultra-compétitifs.
« Shein et Temu ne réussiront probablement plus à recruter autant de nouveaux clients qu’auparavant sur le marché américain », analyse Kimber Maderazzo, professeure de marketing à la Pepperdine Graziadio Business School. Elle précise que « les deux entreprises concentrent désormais leurs efforts sur la fidélisation de leur clientèle existante aux États-Unis, tout en intensifiant leur stratégie de conquête à l’international ».
Face à ces nouvelles contraintes, les deux entreprises basées à Singapour ont pris des mesures drastiques. D’une part, elles ont considérablement réduit leurs dépenses publicitaires numériques aux États-Unis, avec une baisse estimée à 31 % pour Temu et à 19 % pour Shein entre fin mars et mi-avril. D’autre part, elles ont commencé à augmenter le prix de leurs produits pour compenser l’impact des droits de douane, ce qui pourrait affecter leurs marges bénéficiaires.
Cette offensive publicitaire en Europe commence à porter ses fruits. Au Royaume-Uni, les téléchargements de l’application Shein ont progressé de 25 % d’un mois sur l’autre, tandis que ceux de Temu ont plus que doublé. Toutefois, l’impact sur le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens reste modeste, avec une hausse limitée à 5 % pour Shein et 10 % pour Temu.
La stratégie de réorientation géographique ne se limite pas à l’Europe. Le Brésil devient également un marché prioritaire, notamment pour Shein qui y fabrique des produits destinés à l’Amérique latine. En avril dernier, l’entreprise a augmenté ses dépenses publicitaires numériques dans ce pays de 140 % par rapport à l’année précédente. Temu, pour sa part, a multiplié ses investissements publicitaires au Brésil par 800 en un an, anticipant son lancement officiel.
Cette réorientation soulève plusieurs questions quant à l’avenir de ces plateformes. Leur modèle économique, basé sur des prix extrêmement bas et une logistique optimisée depuis la Chine, sera-t-il viable face aux évolutions réglementaires ? L’Europe, avec ses propres règles douanières, offrira-t-elle un terrain aussi favorable que les États-Unis ne l’ont été jusqu’à présent ?
La bataille entre ces géants chinois et les enseignes européennes traditionnelles telles que Zara, H&M ou encore les marques du groupe Gap s’intensifie donc sur le sol européen. Les distributeurs locaux devront redoubler d’efforts pour défendre leurs parts de marché face à ces nouveaux concurrents agressifs et dotés de moyens publicitaires considérables.
Pour Kara Lee, analyste chez Sensor Tower, cette approche n’est pas nouvelle : « Shein a fait de même lorsque Temu est entré sur le marché américain en septembre 2022. Je pense qu’ils utilisent probablement une stratégie similaire au Brésil. » Cette observation suggère un modèle d’expansion internationale bien rodé, adapté aux contraintes réglementaires locales par les deux entreprises.