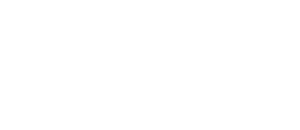Le rideau est tombé sur une icône. Hulk Hogan, de son vrai nom Terry Bollea, nous a quittés ce jeudi à l’âge de 71 ans, dans sa maison de Clearwater, en Floride. Les services d’urgence, appelés pour un arrêt cardiaque, l’ont transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté. Avec lui, c’est une page monumentale de la culture populaire et du sport-spectacle qui se tourne. On le croyait indestructible et éternel, à l’image du personnage qu’il avait créé. Mais la réalité a fini par rattraper la légende.
Il y avait Terry, l’homme, et il y avait Hulk, le personnage. Terry Bollea lui-même disait que dès qu’il franchissait le seuil de sa maison, le monde ne voulait plus de lui, mais de son alter ego. Le facteur ne l’appelait pas « Monsieur » mais « Hey, Hulk ». Il devait alors enfiler le costume, jouer le jeu et répondre « Hey, brother » avec sa voix rauque si caractéristique. Cette dualité permanente a défini sa vie, une existence passée sous les projecteurs, où la frontière entre la personne et le personnage était devenue presque invisible pour des millions de fans.
Né en Géorgie en 1953, Terry Gene Bollea était le fils d’un contremaître et d’une professeure de danse. Destiné à une carrière sportive en raison de son physique hors norme, il se blesse en jouant au baseball et se tourne vers sa véritable passion : le catch, qu’il regardait à la télévision. Après avoir abandonné ses études universitaires, il monte sur le ring en 1977. Avec sa taille de 2,03 mètres et un poids avoisinant les 135 kilos à son apogée, il a imposé un nouveau standard de gabarit dans la discipline.
C’est à cause de sa musculature impressionnante qu’il est comparé au personnage de la série télévisée L’Incroyable Hulk. Le surnom est trouvé. Il ne lui manque plus qu’un nom. En rejoignant la World Wrestling Federation (WWF), il adopte le patronyme irlandais « Hogan », qui sonne bien dans un milieu où les origines ethniques sont souvent mises en avant pour caractériser les personnages. À ses débuts, avec ses longs cheveux blonds, il incarne parfaitement le « heel », le méchant, face à des héros propres sur eux comme Bob Backlund.
La bascule s’opère en 1982. Sylvester Stallone lui offre un rôle dans Rocky III. Il y interprète Thunderlips, un catcheur arrogant et surpuissant qui affronte Rocky Balboa lors d’un match de gala. Sa prestation, bien que brève, marque les esprits. Hulk Hogan n’est plus seulement une star du catch, il devient une personnalité connue du grand public. Son retour à la WWF en 1983 se fait sous une nouvelle lumière. Sa popularité est telle qu’il devient un « face », un gentil, malgré son apparence moins conventionnelle que les standards de l’époque.
Cette période marque le début de l’« Hulkamania ». La WWF lui crée une personnalité patriotique. Il fait son entrée sur le ring sur la chanson Real American et affronte des adversaires représentant les rivaux géopolitiques des États-Unis, comme l’Iranien Iron Sheik ou le Soviétique Nikolai Volkoff. Il encourageait ses fans, les « Hulkamaniacs », à s’entraîner, à prier et à prendre leurs vitamines. Cette image saine sera pourtant écornée plus tard, lorsqu’il admettra, en 1994, avoir eu recours aux stéroïdes pour sculpter son physique.
Suivez toute l’actualité d’Essential Homme sur Google Actualités, sur notre chaîne WhatsApp, ou recevoir directement dans votre boîte mail avec Feeder.
Le point culminant de sa carrière reste sans doute le WrestleMania III de 1987, qui s’est déroulé dans le Silverdome du Michigan devant plus de 93 000 spectateurs. Son match contre André the Giant, une légende française invaincue depuis 15 ans, est entré dans l’histoire. Le moment où Hogan soulève et projette au sol les 225 kilos d’André est devenu un événement planétaire. Bien que l’issue des combats de catch soit prédéterminée, l’impact visuel et symbolique de cet exploit a renforcé son statut de superstar absolue.
Après avoir atteint les sommets, Hulk Hogan se lance dans une carrière cinématographique avec des films comme No Holds Barred (1989) ou Mr. Nanny (1993), mais le succès est mitigé. Au milieu des années 1990, alors que sa carrière sur le ring est en berne, il se réinvente de manière spectaculaire en rejoignant la ligue concurrente, la World Championship Wrestling (WCW). Il y devient le méchant « Hollywood » Hogan et fonde le clan « New World Order » (nWo). Ce virage audacieux relance sa carrière et prouve son intelligence du spectacle.
Loin des rings, sa vie privée devient elle-même un spectacle. La série de téléréalité Hogan Knows Best (2005-2007) expose son quotidien familial, mais fissure l’image de la famille parfaite. S’ensuit un divorce acrimonieux avec sa première femme, Linda, qui l’accuse d’abus et d’infidélité. Cette période sombre le plonge dans une profonde dépression, au point qu’il avoue avoir envisagé le suicide, qu’il dit avoir évité de justesse grâce à un appel téléphonique d’une amie.

Le scandale le plus retentissant reste son procès contre le site d’information Gawker. En 2012, ce dernier publie des extraits d’une vidéo intime le montrant avec la femme d’un ami. Hogan l’attaque pour atteinte à la vie privée, arguant que la publication n’avait aucune valeur informative. L’affaire, financée en coulisses par le milliardaire Peter Thiel, qui entretenait un contentieux personnel avec Gawker, a eu un retentissement énorme. Hogan a obtenu 140 millions de dollars de dommages et intérêts, ce qui a poussé Gawker Media à la faillite. Ce cas a soulevé d’importantes questions sur la liberté de la presse face au droit à la vie privée.
Mais les ennuis ne s’arrêtent pas là. En 2015, des enregistrements issus de cette même vidéo le révèlent en train de tenir des propos racistes. La sanction de la WWE est immédiate : il est renvoyé et effacé de l’histoire officielle de la fédération. Il présentera des excuses publiques, expliquant son embarras et affirmant ne pas être raciste – « Je ne suis pas raciste, mais je n’aurais jamais dû dire ce que j’ai dit », a-t-il déclaré lors de l’émission Good Morning America diffusée sur la chaîne ABC. « C’était une erreur. J’en suis embarrassé. » – avant d’être réintégré trois ans plus tard.
Malgré ces polémiques, l’impact de Hulk Hogan sur l’industrie du divertissement sportif reste considérable. Il a transformé le catch, qui était une attraction régionale, en un phénomène planétaire générant des milliards de dollars.
Sa famille lui survit. Ses enfants, Brooke et Nick, sa troisième épouse, Sky Daily, ainsi que ses deux petits-enfants lui survivent. Son ami de longue date, Ed Leslie, plus connu sous le nom de Brutus Beefcake, faisait partie de son cercle proche depuis le début de leur carrière.
L’homme qui se cachait derrière le personnage cherchait toujours à préserver une certaine normalité. « Le moment où je rentre à la maison, le bandana quitte ma tête chauve et je redeviens Terry : papa, père, mari, ami », confiait-il récemment.
Hulk Hogan laisse derrière lui un empire bâti sur le spectacle et la performance. Son influence dépasse largement les frontières de la lutte pour toucher la culture populaire américaine. Sa disparition marque la fin d’une époque où les héros musclés incarnaient l’idéal américain sur les rings du monde entier.
Hulk Hogan était une figure complexe. Un homme qui a transformé une discipline régionale en une industrie mondiale de plusieurs milliards de dollars grâce à son charisme et à son sens du spectacle. Mais derrière les « pythons de 24 pouces » et les T-shirts déchirés se cachait Terry Bollea, un homme qui a lutté contre la célébrité, la dépression et les conséquences de ses propres erreurs. Il a incarné le rêve américain dans toute sa splendeur et ses excès : un géant du divertissement dont l’héritage, glorieux et controversé, ne laissera personne indifférent.