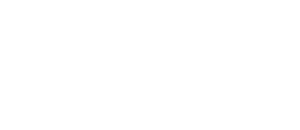Les dieux de pierre sont de retour. Après des décennies d’exil, des centaines de statues cambodgiennes volées envahissent aujourd’hui les couloirs du Musée national du Cambodge à Phnom Penh. Leur retour au pays est célébré à la fois comme une reconnaissance spirituelle et un casse-tête logistique. Sculptés entre le IXème et le XIVème siècle, à l’apogée de l’Empire khmer, ces objets portent les cicatrices de la guerre, du vol et d’un marché de l’art mondial qui les a pris pour des trophées. Aujourd’hui, leur présence soulève des questions urgentes sur la préservation, l’identité culturelle et la définition de la valeur du passé.
Pour les Cambodgiens, ces statues ne sont pas des reliques, mais des canaux vivants vers leurs ancêtres. « Ils viennent voir les dieux, ou être vus par les dieux », a déclaré Huot Samnang, directeur du département des antiquités du Cambodge, en désignant une figure en grès de la déesse hindoue Uma datant du Xe siècle. La statue, qui avait été rapatriée du Metropolitan Museum of Art de New York en 2024, se trouvait autrefois dans un temple de la jungle avant d’être exportée clandestinement à l’étranger pendant le chaos du régime des Khmers rouges. Son retour, comme celui de dizaines d’autres, a relancé les débats sur la manière dont une nation reconstruit son patrimoine après des générations de traumatismes.

La cour du Musée national raconte l’histoire d’un effort de rapatriement qui a dépassé les infrastructures. Un après-midi récent, des statues de la taille de réfrigérateurs étaient recouvertes de mousse sous les avant-toits rouge sang du bâtiment, en attendant d’être installées. À l’intérieur, les galeries conçues il y a un siècle pour 500 objets en contiennent aujourd’hui 1 400, les visiteurs se faufilant coude à coude parmi les chefs-d’œuvre de l’art angkorien. « L’espace », a répondu Chhay Visoth, le directeur du musée, lorsqu’on lui a demandé quelle était sa priorité absolue. Les projets d’agrandissement, financés en partie par la France et des magnats cambodgiens, sont toujours bloqués par la bureaucratie et les différentes conceptions de l’avenir de l’institution.
La surpopulation met en évidence un paradoxe : alors que les musées occidentaux sont soumis à des pressions pour restituer les objets pillés, la capacité du Cambodge à les accueillir reste limitée. Environ 4 000 pièces restent à l’étranger, selon Bradley Gordon, un avocat qui conseille le gouvernement cambodgien. Les récents rapatriements, dont 14 sculptures du Met et 70 objets provenant de collectionneurs privés, ont submergé le personnel. « Nous réunissons les statues avec leurs piédestaux, réparons les dommages et cherchons comment raconter leur histoire », a déclaré Chhay. « Mais nous avons d’abord besoin d’un endroit où les mettre. »
Le voyage de retour de ces statues commence souvent dans les endroits les plus improbables. En 2022, James H. Clark, le fondateur de Netscape, a rendu une statue de Garuda du XIIᵉ siècle, un protecteur mi-humain, mi-oiseau, qui ornait son salon. « Pourquoi voudriez-vous posséder quelque chose qui a été volé ? », a-t-il déclaré au New York Times. D’autres pièces, comme un Bouddha en bronze protégé par un serpent mythique, ont été données par la famille de George Lindemann, un philanthrope décédé dont la collection comprenait des objets associés à Douglas Latchford, un marchand d’art en disgrâce.
Latchford, décédé en 2020 alors qu’il était mis en examen pour trafic, occupe une place importante dans cette saga. Pendant des décennies, il a fourni des objets khmers à des musées tels que le Met et le Norton Simon, dont beaucoup ont été prélevés dans des temples pendant la guerre civile au Cambodge. Ses livres, autrefois salués comme des références savantes, sont désormais lus comme des inventaires de pertes. « Ils ont documenté des trésors dont nous ne savions même pas qu’ils avaient disparu », a déclaré Anne LeMaistre, ancienne directrice de l’UNESCO à Phnom Penh.

Les défis du Musée national vont au-delà du stockage. Pour de nombreux Cambodgiens, l’institution fonctionne moins comme une galerie que comme un espace sacré. Les visiteurs laissent souvent des offrandes près des statues, selon les rituels pratiqués dans les temples ruraux. « Il ne s’agit pas seulement d’art, mais aussi d’âmes », a déclaré Helen Jessup, spécialiste de l’architecture cambodgienne. Pendant les fêtes bouddhistes, les fleurs s’entassent sous une représentation de Shiva datant du Xe siècle, malgré les panneaux demandant aux visiteurs de ne pas toucher les statues.
Les conservateurs marchent sur une ligne fine. Les étiquettes expliquant les scènes de bataille du Mahabharata ou le réseau de traite des êtres humains de Latchford n’ont été ajoutées que récemment, après que les touristes se sont plaints de la confusion. « Nous devons éduquer sans aliéner », a déclaré Chhay. Les réformes proposées, telles que des galeries climatisées, des programmes scolaires et des expositions prêtées, sont en concurrence avec les appels au retour des statues sur leurs sites d’origine, comme les temples pillés de Koh Ker. « Si nous les renvoyons, seront-elles en sécurité ? », demande Chhay. « Ou seront-elles à nouveau pillées ? »
Chaque statue restituée porte le poids de l’histoire. Entre 1975 et 1979, les Khmers rouges ont exécuté jusqu’à un quart de la population cambodgienne, dont l’ancien directeur du Musée national. L’effondrement du régime a laissé les temples sans surveillance, permettant aux pillards de découper les statues de leurs piédestaux à la tronçonneuse. « Ces objets sont des survivants », a déclaré Bradley Gordon. « Leur retour aide les survivants du génocide à guérir. »
Cependant, la campagne de restitution du Cambodge se heurte à des obstacles. Certaines institutions occidentales expriment leurs préoccupations concernant les normes de conservation, bien que le Musée national se soit associé à des experts du Musée Guimet à Paris pour moderniser les laboratoires et les entrepôts. D’autres, comme le Met, ont rendu certaines pièces tout en en conservant d’autres. « Le Met continuera à s’engager auprès du Cambodge », a déclaré la porte-parole Ann Bailis, bien que les critiques affirment que la coopération du musée a été inégale.
Alors que le Cambodge réfléchit à la marche à suivre, les spécialistes citent le musée de l’Acropole, en Grèce, comme modèle. Ouvert en 2009, il expose les marbres du Parthénon pillés aux côtés de répliques de pièces conservées au British Museum, faisant du rapatriement un impératif moral. « Imaginez une aile ici qui reconstitue les temples de Koh Ker et montre à quelle statue chacune appartenait », a déclaré Ashley Thompson, historien de l’art khmer. « Cela pourrait transformer les victimes en défenseurs. »
Pour l’instant, la cour du Musée national reste un purgatoire de fortune pour les dieux en transit. Les ouvriers ont récemment déballé une statue de Bouddha de 2,10 mètres de haut revenue de chez Christie’s, les bras toujours croisés dans une vigilance éternelle. À proximité, un Vishnu sans tête gisait sur une palette, attendant de retrouver son corps. « Ce ne sont pas que des pierres », a déclaré Chhay. « C’est la preuve que nous sommes toujours là. »