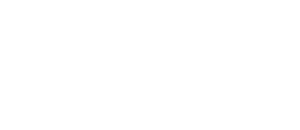Peu de vêtements peuvent se vanter d’une histoire aussi riche que celle de la vareuse. Autrefois cantonnée au dur labeur des marins, cette tenue s’est aujourd’hui frayée un chemin jusqu’aux garde-robes urbaines les plus pointues.
Son parcours illustre une fascinante transition du fonctionnel au stylistique.
De simple blouse de grosse toile, elle est devenue un symbole d’élégance décontractée. Comprendre son évolution, c’est toucher du doigt un morceau d’histoire maritime tout en décryptant une tendance forte de la mode contemporaine. La vareuse, intemporelle, continue de séduire par son authenticité brute et sa polyvalence.

Un vêtement né de l’ingéniosité maritime
L’histoire de la vareuse commence sur les côtes bretonnes, bien avant que les créateurs de mode ne s’y intéressent. Selon la légende, des marins auraient taillé ce vêtement dans les voiles usées de leurs bateaux pour se protéger des éléments. L’étymologie même du mot, issue du normand « varier » signifiant « protéger », ancre ce vêtement dans sa fonction première. Conçue pour résister au vent, au froid et aux embruns, elle était avant tout un outil de travail.
Ses caractéristiques originales témoignent d’une conception entièrement tournée vers la praticité en mer. La toile de coton, épaisse et robuste, garantissait une protection efficace. Pour en assurer l’étanchéité, les marins l’enduisaient parfois d’huile de foie de morue. Sa coupe était conçue pour assurer la sécurité : ample pour ne pas entraver les mouvements, elle ne présentait aucune aspérité extérieure.
Le col fendu, si caractéristique, pouvait se fermer grâce à un bouton unique, discrètement placé à l’intérieur pour éviter tout risque d’accrochage aux cordages. Pour la même raison, les poches se trouvaient également à l’intérieur, au niveau de la poitrine. La vareuse était un vêtement lisse, presque une seconde peau fonctionnelle. Les couleurs elles-mêmes avaient une signification et permettaient de reconnaître l’équipage d’un port ou d’un village. Le bleu à Boulogne, le rouge à Concarneau : chaque teinte racontait une appartenance. La patine du tissu indiquait enfin l’ancienneté du marin.
De l’uniforme de travail à l’icône de mode
Le passage de la vareuse au vestiaire civil s’est opéré progressivement. Dès la fin du XIXe siècle, les tenues d’inspiration marine séduisent la haute bourgeoisie qui habille ses enfants de ces costumes pour les sorties du dimanche. Ce premier pas marque le début d’une lente démocratisation.
Au début du XXe siècle, avec l’essor des loisirs en bord de mer, la vareuse est adoptée par les élites comme un vêtement de détente chic. Elle quitte alors les ponts des bateaux de pêche pour les stations balnéaires à la mode. Cependant, elle reste dans l’ombre de sa cousine, la marinière, qui a été largement popularisée par les créateurs.
C’est dans les années 1960 que sa place dans la mode change véritablement. Le cinéma joue un rôle clé dans sa popularisation, notamment grâce au film culte Les Demoiselles de Rochefort, dans lequel le personnage de Maxence en porte une version blanche. Parallèlement, la navigation de plaisance se développe, rendant les vêtements marins accessibles à un public plus large, à la recherche de confort et de protection contre le vent lors de balades côtières.
Suivez toute l’actualité d’Essential Homme sur Google Actualités, sur notre chaîne WhatsApp, ou recevoir directement dans votre boîte mail avec Feeder.
La vareuse dans le vestiaire contemporain
Aujourd’hui, la vareuse a pleinement intégré le vestiaire contemporain. Elle n’est plus réservée aux gens de mer. Des créateurs et des marques de prêt-à-porter se l’approprient, la déclinant dans des coupes plus ajustées, des couleurs variées et de nouvelles matières. Des maisons de luxe telles que Céline ou Jacquemus ont même proposé leur propre interprétation de cette pièce historique, témoignant ainsi de sa capacité à se réinventer.
La vareuse moderne est souvent unisexe, brouillant les frontières entre les vestiaires masculin et féminin. Elle conserve ses atouts fondamentaux : une coupe ample pour le confort et une toile résistante qui traverse les années. Son authenticité séduit une population urbaine en quête de vêtements ayant une histoire. Elle est devenue une star des friperies, où l’on peut trouver des pièces vintage à la patine unique.
Pour l’intégrer à une tenue actuelle, les possibilités sont multiples. Elle se marie simplement avec un jean brut et des mocassins pour une allure à la fois décontractée et élégante. Portée ouverte sur une marinière, elle compose une silhouette classique d’inspiration marine.
Sa polyvalence en fait une pièce idéale pour la mi-saison, un excellent coupe-vent qui apporte une touche de caractère sans effort. Robuste et fonctionnelle, elle reste fidèle à ses origines tout en s’adaptant parfaitement aux exigences de la vie moderne.